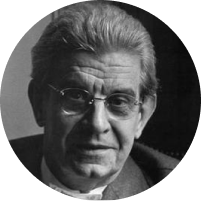De 9h à 19h !
Tuer son symptôme
Enric Berenguer
Dans l’histoire de l’humanité, les pires désastres ont été faits au nom du bien. Et, une des formes les plus dangereuses de l’application de cette prémisse du bien dans la politique, passe par l’idée de solution. À chaque fois qu’on commence à trop entendre parler de solutions, il y a de quoi se mettre à frémir du pire que cela augure.
Or, nous vivons un temps de solutions. Ce qu’on appelle populisme en politique — dont il y en a tant de versions qu’on dirait que c’est simplement un nom de la politique d’aujourd’hui — est souvent, sinon toujours, un discours des solutions. L’on est excédés par les problèmes que l’on connaît depuis toujours et de constater les partis politiques “traditionnels”, “l’establishment”, etc., s’avèrent incapables d’y apporter une solution. Alors, il faut trouver des nouvelles solutions, et le faire vite — dans le style qu’a le sujet contemporain de vivre le temps, celui de sa vie : l’attente, l’insistance, même la patience, n’ont plus de place.
On s’affaire donc à trouver des problèmes non résolus et, dans le marché des discours politiques disponibles, on peut facilement choisir celui qui promet la solution la plus rapide et radicale. Y’a t-il de l’immigration ? Le plus évident est, sans doute, d’ériger un mur, ou bien d’empêcher quelques pauvres bateaux d’arriver dans un port ou sur une plage — avec le cynique espoir que ce seront le désert ou la mer qui feront le reste. Est-on mal dans l’Europe ? Ne répond-elle pas à ce que nous en attendions ? Alors, c’est facile : on s’en va !
Le rapport de Donald Trump avec ses voisins du Sud est à cet égard très parlant. Des pays comme le Honduras et le Salvador et, d’un point de vue plus large, toute la région, ont souffert pendant des décennies des politiques agressives de la part des États-Unis qui, parfois, sont intervenus très violemment, empêchant la construction de solutions démocratiques originales (le Guatemala avec Arbenz, par exemple), tout en retirant, d’autre part, des bénéfices énormes d’une main-d’œuvre clandestine (Mexique, Guatemala, Salvador, Honduras), sans aucune protection et qui devait accepter des salaires de misère dans des conditions inhumaines de vie.
Mais voilà que ces personnes résistent, qu’ils vivent leur vie et qui font entendre partout leurs accents doux, leur musique et leur manière de vivre. Le pire étant qu’ils peuvent même parvenir à constituer une certaine communauté, non négligeable dans les calculs électoraux ! Il faudra donc construire un mur, pour en finir avec ce à quoi on a décidément participé.
C’est la même chose avec la production et le trafic de cocaïne, par les pays voisins des États-Unis : aucune “War on drugs” — ce qui a justifié toute une politique, avec des mesures militaires et une alliance presque perpétuelle entre les “tough guys” du spectre politique de toute la région — ne peut voiler le statut de symptôme dont un élément fondamental est la demande intarissable de stupéfiants. Qu’importe que “the U.S. Opioid Epidemic”, les “Synthetic drugs” et même les “designer drugs”, démontrent que le marché des jouissances nord-américain peut, assez bien, se passer des importations du sud.
On a déjà une perspective suffisante pour savoir ce que donnent les solutions “radicales” et définitives. Ce qui ne fait aucun doute, c’est que cela multiplie les morts et la souffrance. Mais voilà que les problèmes persistent et, parfois même, s’aggravent. Et, qui plus est, les consignes brutales lancées aux quatre vents “pour en finir” tendent à aggraver les symptômes qui devaient disparaitre. Et même elles suscitent des réponses inattendues. Le rejet le plus brutal produit quelquefois un effet d’appel paradoxal.
En voilà un exemple, celui de la caravane qui depuis le Honduras a traversé l’Amérique Centrale et le Mexique, et qui est maintenant parvenue jusqu’aux portes, ou plutôt jusqu’au mur, des États-Unis de Donald Trump. Même la menace explicite de la mort est sans effet sur ceux qui cohabitent quotidiennement avec la mort dans ses formes les plus brutales. Qui sait même si, face à une mort banale et anonyme — une unité de plus à ajouter aux chiffres habituels — on peut y préférer une mort qui résulterait d’un défi contre les maîtres du monde, sous les yeux du regard universel des médias. Phénomène collectif, d’autre part, qui fait passer ce qui normalement relève de la solitude de chacun à ce qui, dans les structures du fantasme y et la temporalité du passage à l’acte, est susceptible d’être partagé dans l’illusion d’une communauté.
Nous avons tous — partout il y en a — des symptômes dont on n’en veut pas. C’est ce qui fait que, en Europe par exemple, les années 30 font retour. C’est stupéfiant de voir comment on reprend des discours et on revendique même des figures de solutions promises qui ont conduit au désastre. Avec l’espoir que, cette fois, on fera mieux — bien sûr ! —, puisqu’on connaît quand et pourquoi on s’est trompés : on ne va pas répéter les mêmes erreurs, mais seulement reprendre quelques bonnes inspirations, très bien justifiées au nom du bien pour, cette fois, les conduire à la fin que l’ange de l’histoire leur aurait arrachée.
Chez nous, en Espagne, c’est le symptôme “Transition” et la “mémoire” de la Guerre ; le retour à ce qui au fil des années semblait possible. Fantasme de mémoire construit sur des oublis sélectifs — chacun le sien, que ce soit insu ou inavouable. On n’en veut plus de ce symptôme dont nul ne veut se faire responsable. On préfère trancher, s’en aller, tout découvrir : la vérité, sans voiles, devrait nous sauver. Tandis que, de l’autre côté, on prétend substituer aux liens de la parole ceux de la pire version de la loi. Loi dans laquelle, au fond, ils n’ont jamais vraiment cru. Et on répond, tant aux abus de la mémoire qu’à son évocation légitime, avec son simple et pur effacement ou une manipulation cynique de l’histoire.
Récemment, Antoni Puigverd, dans La Vanguardia, disait que ceux qu’ont vécu la fameuse Transition n’avaient pas besoin d’une loi de la mémoire, puisqu’on se souvenait très bien et on voulait autre chose. (1)
Récemment aussi, un livre de conversations est paru, signé par un journaliste et un jeune protagoniste de la politique espagnole. Le titre est intéressant : Nœud Espagne (2). Voilà une topologie plus intéressante, quelque chose, peut-être, un peu plus près du réel qui, lui, ne se laisse pas réduire à des catégories binaires : dehors/dedans, nous/eux, problème/solution.
Bien sûr, il y a des vieux symptômes qu’il nous faut traiter ; assurément, ils ont perdu une partie de leur efficacité. Mais pour les traiter il faut commencer pour s’en faire responsables. Il faut voir ce que nous faisons avec les ficelles du nœud, même quand il s’agit d’en faire autre chose. Puisque chaque ficelle est un lien, qu’on veuille ou pas le reconnaître.
(1) Antoni Puigvert, “Cólera”, La Vanguardia, 05/11/2018
(2) P. Iglesias, E. Juliana, Nudo España, Arpa, 2018.
Adresse: Université de St. Louis, Salle OM 10
6, rue de l'Ommegang, 1000 Bruxelles
Traductions simultanées en français, anglais et néerlandais
Horaire: 9h -19h
|
New Lacanian School Nous contacter : accueil@amp-nls.org Inscription : https://amp-nls.org/page/fr/42/sinscrire-nls-messager Le site de la NLS : https://amp-nls.org Lacan Quotidien : http://www.lacanquotidien.fr/blog/ |
New Lacanian School
website
: |